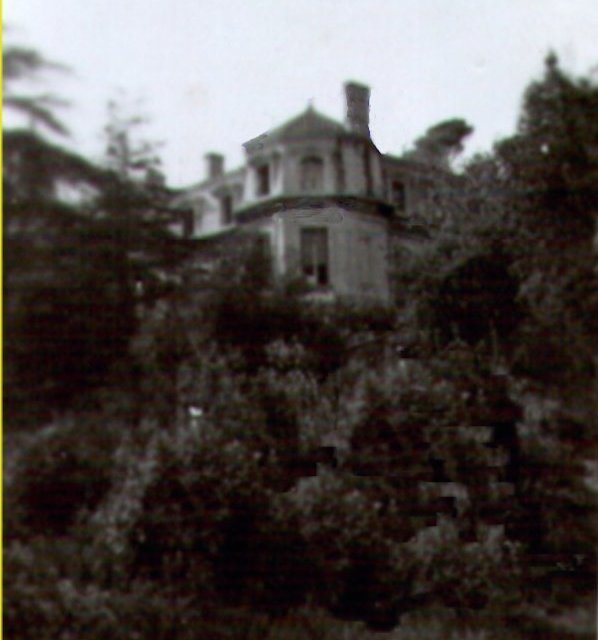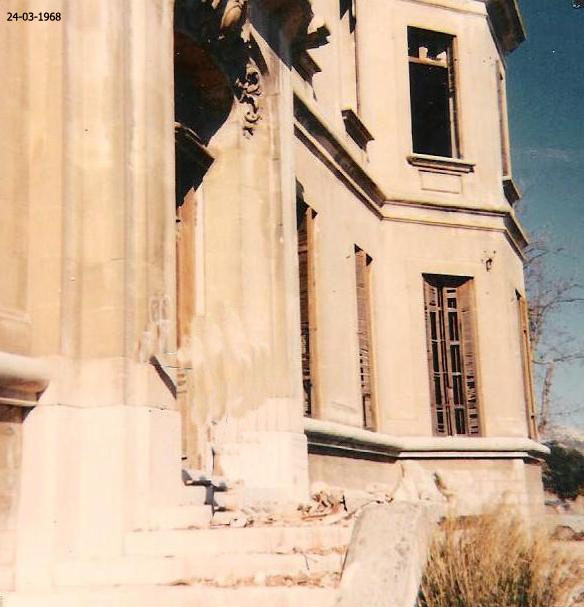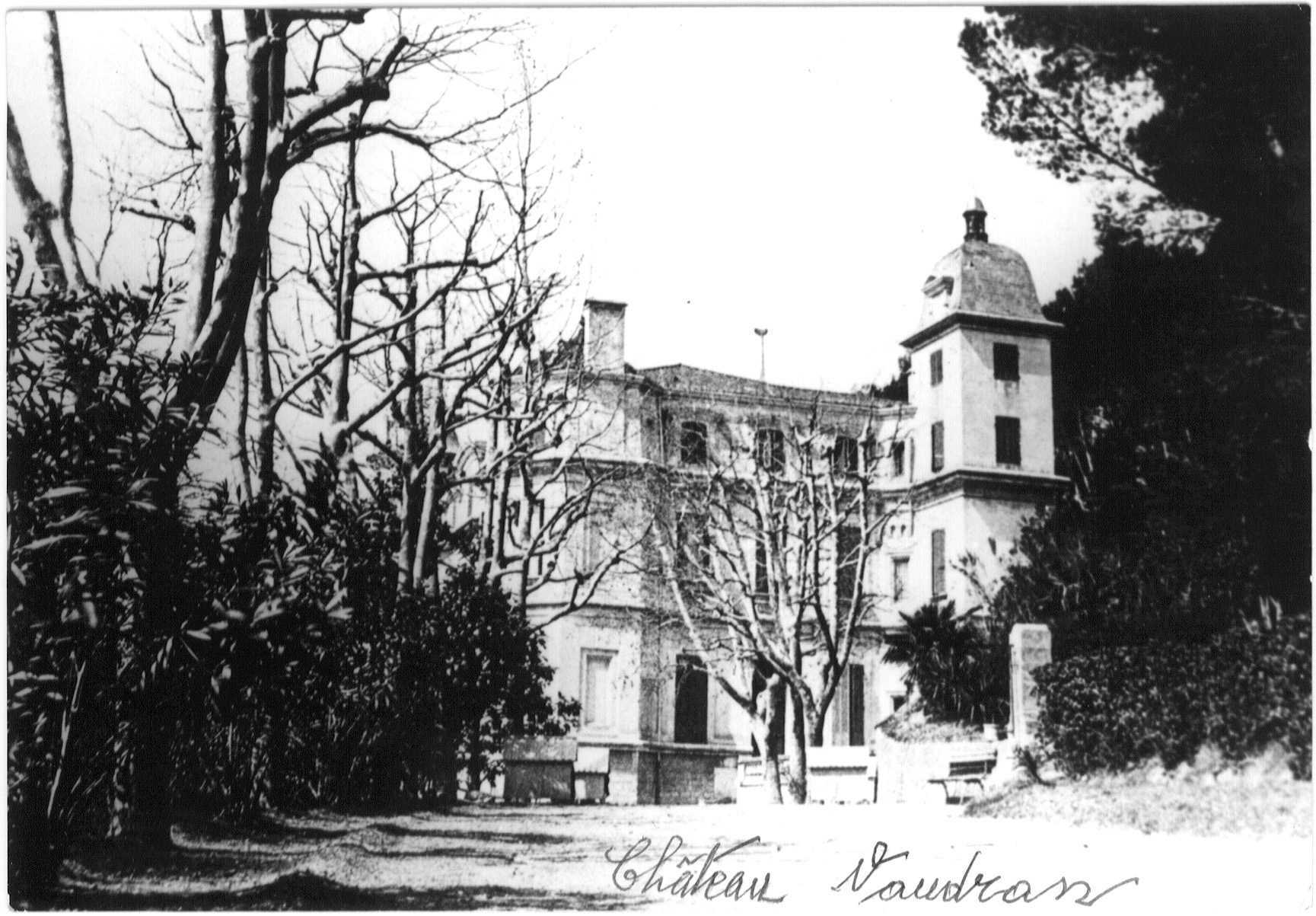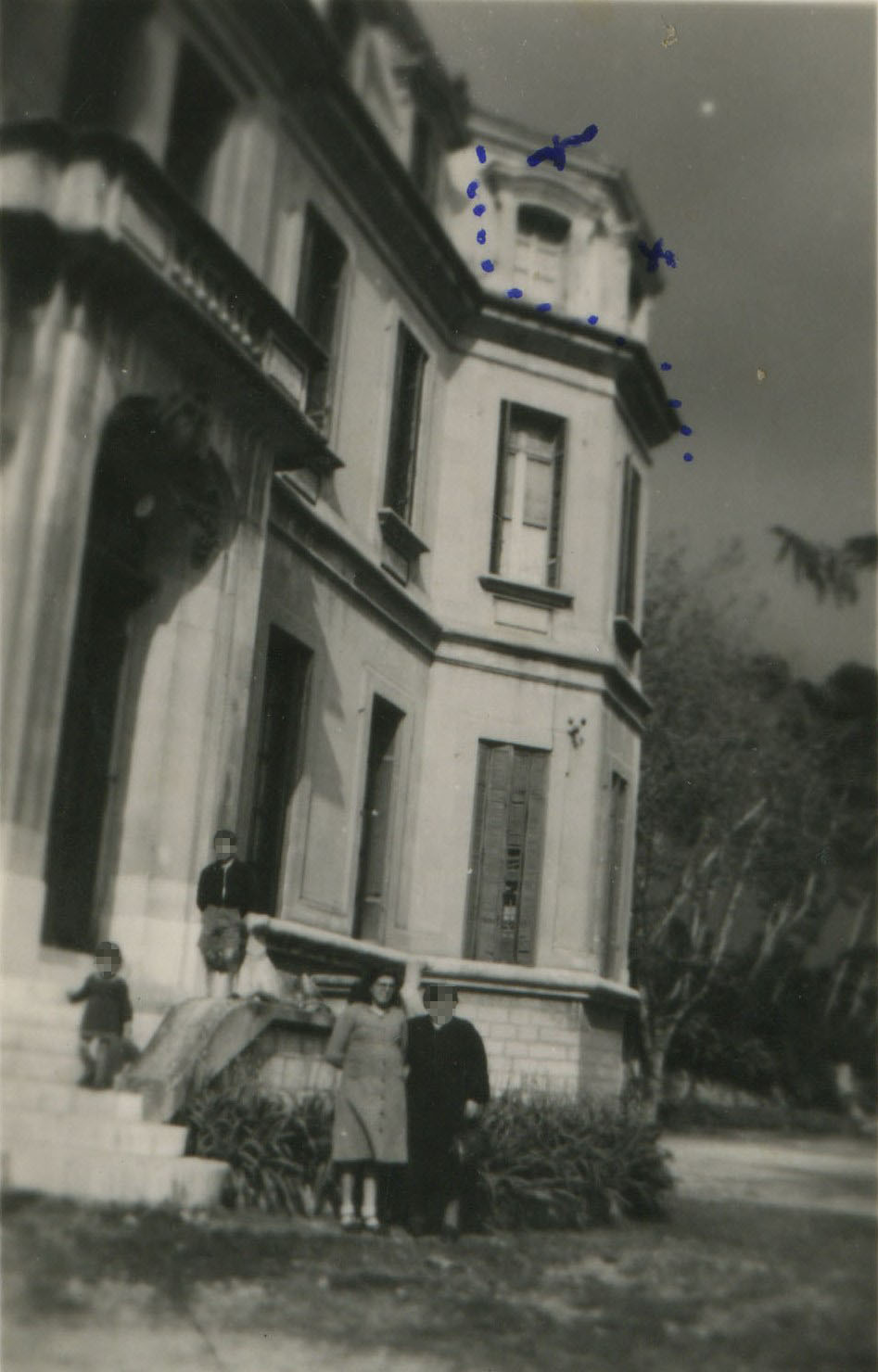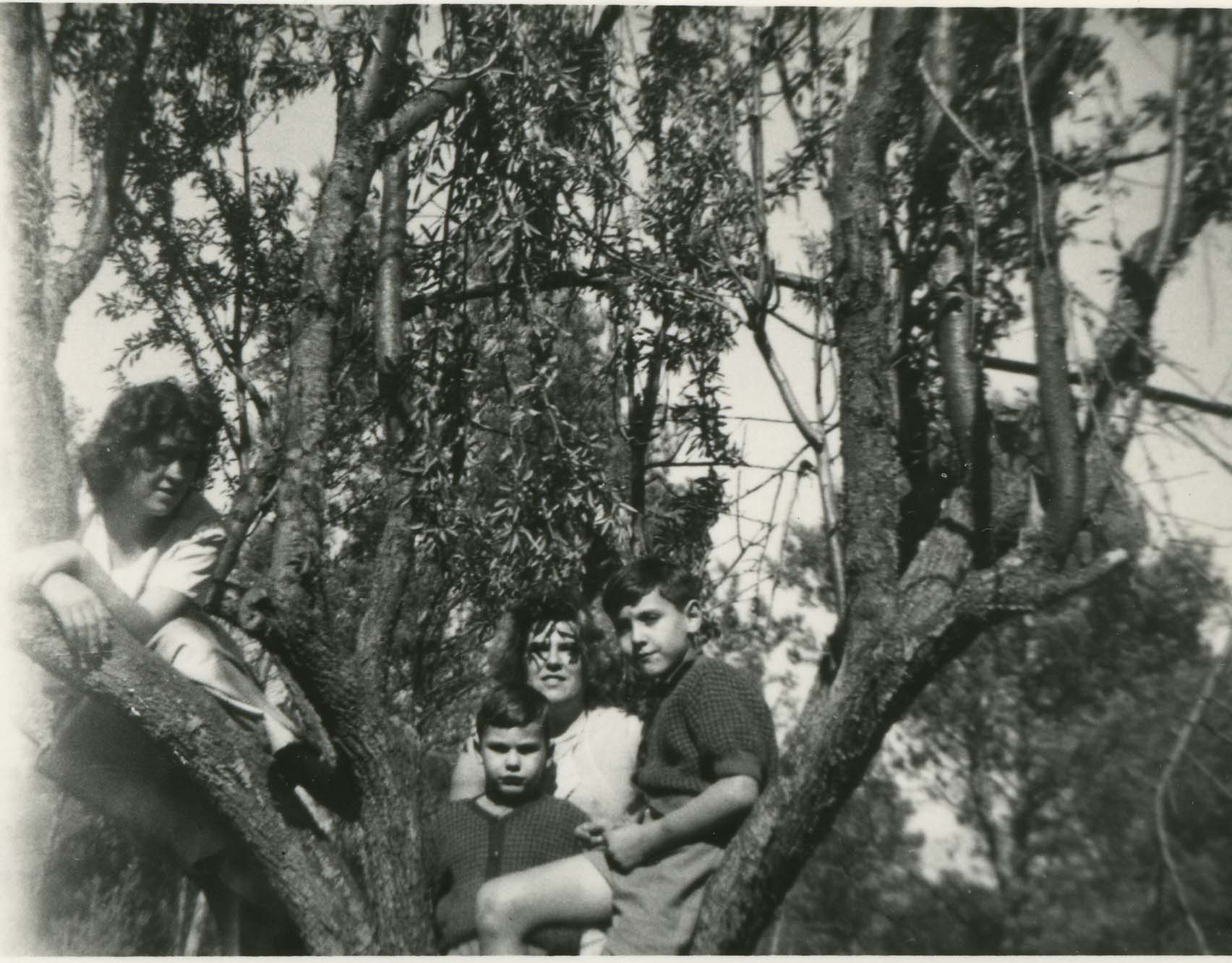|
Préliminaires
:
De
1943 à la
Libération, l'occupant allemand
enferma des prisonniers dans les caves du château,
transformées pour l’occasion en cellules. Cette prison souterraine
servit par la suite d’aire de jeux (interdits) aux enfants. Les murs
étaient couverts d’admirables tableaux tracés à la craie de couleur.
L’entrée
principale du château était fermée par une énorme porte de bois à
double battant, épaisse de dix centimètres et haute de trois mètres.
Malgré
son énorme masse, elle s’ouvrait facilement sur un hall d’entrée qui
aurait pu loger un appartement entier. Après
la débâcle allemande, les habitants du quartier de La Valentine, firent
des raids sur le château et détruisirent les relais électriques et la
plupart des sanitaires. Aucune robinetterie présente dès l'origine ne
fonctionna jamais. pourtant ces anciennes demeures étaient toutes
équipées d'un système encestral appelé "bélier hydrolique" qui
permettait de faire circuler l'eau parfois sur des hauteurs importantes
sans mécaniques compliquées, faciles à entretenir.
Au lendemain de la dernière
guerre
mondiale, Marseille affrontait une grave crise du logement. Des
quartiers entiers étaient à reconstruire. Pour y
faire face, la municipalité n’hésitait pas à suggérer ces vieilles
demeures totalement dépourvues du plus élémentaire confort.
L'installation
des premiers
squatters :
Ma famille s'installa en 1949 dans le château dont une
aile était déjà occupée par plusieurs familles maghrébines. Pour
y accéder à partir du village de La Valentine (11ème
arrondissement de Marseille) il fallait suivre le canal en direction du
quartier de "La Bouquière" par la "route des trois Lucs à La Valentine"
. A
droite on prenait l'impasse des Vaudrans (abusivement baptisée au
pluriel - le domaine de Vaudran s'édicte au singulier), on longeait le
vieux cimetière,
traversait des champs puis le bois du domaine de Vaudran.
L'entrée, désormais soixante-huit impasse des vaudrans, était
matérialisée par
deux énormes piliers soutenant une
épaisse grille en fer forgé, constamment ouverte. Sur plusieurs
centaines de mètres, les arbres, de très vieux cèdres, ne laissaient
jamais filtrer
le soleil tant ils
étaient denses. La route, goudronnée par les allemands, s'était
détériorée en
larges plaques sous l'effet des eaux de ruissellement. Les
ramures des conifères s'arrondissaient en tunnel au
dessus de nos têtes. La traversée de
la forêt devenait une véritable épreuve dans l’obscurité. Je
n'avais que onze ans en CM² et il m'arrivait parfois de manquer de
soins
dans mon travail scolaire. Il y a 50 ans, l'école de la
République était impitoyable.
La punition favorite des enseignants
était la retenue. Il s'agissait de refaire le travail baclé le soir
après 17 heures sous la surveillance du maitre. Il occupait un
appartement de fonction à l'école. Il n'était pas rare d'être libéré
deux
heures après la fin de l'école. En marchant d'un bon pas, il fallait
bien 1/2 heure pour parcourir les trois km qui me séparaient du
château.
J'arrivais donc sous ces terribles cèdres vers dix-huit heures. En
hiver il fait
déjà nuit. Je devais obligatoirement passer devant les ruines d'une
énorme batisse qui m'effrayait beaucoup. Les squatters du château
l'avaient baptisée "la maison cassée". Et un soir, fatigué de devoir
encore franchir ces obstacles, je décidais de choisir un autre chemin :
une voie privée bien dégagée mais qui avait l'inconvénient de passer
devant la propriété du riche paysan local un certain André (nom de
famille). Madame André m'attendit au bout du chemin pour
m'interdire le passage. Elle resta sourde à mes protestations. Dans la
photo (figure 4) du présent, se trouvait un escalier conduisant
directement à la ferme des André, sous le château. Il n'était point
question d'impertinence à l'égard de cette famille, la seule de la
région à disposer d'un téléphone. Notre fratrie, de santé fragile,
avait souvent recours au service de ces gens pour appeler un
médecin.
L'histoire des André
est assez insolite : Elle possédait des
terres agricoles qui furent submergées après la mise en service du
barrage de Serre-Ponçon en 1959. En échange elle obtint une large
propriété issue de l'ancien domaine de Vaudran, désormais propriété de
la ville de Marseille. Les familles squattant le château observaient
une évidente neutralité envers les André dont la réputation de dureté
et d'intransigeance n'était pas à démontrer. Pour le dire simplement,
les André nous méprisaient profondément et le montraient bien. La
famille se
composait de 3 garçons de 8, 11 et 12 ans. Même si les parents étaient
agriculteurs, il n'y avait pas mystère : ils appartenaient à la
bourgeoisie locale, sure d'elle, de son droit et de ses moyens.
Cette neutralité se poursuivait jusqu'à l'école primaire ou nos rares
contacts verbaux avec les frères André étaient limités par leur
arrogance naturelle. Les André étaient une famille de riches.
Mais revenons au château ! Passée la lourde porte d’entrée, on
pénétrait dans le grand hall (que
nous appelions entre nous "le couloir") avec son carrelage à damier.
Sur le mur du fond, les allemands avaient peint une carte de l’Europe.
Je me souviens encore d’elle malgré sa disparition depuis
42ans. Elle était très bien exécutée. Je fus longtemps étonné des
drôles de noms donnés à nos villes - et pour cause - elles étaient
écrites en Allemand. Le mur de gauche affichait une phrase peinte en
lettres gothiques. Je me souviens encore
des premiers mots : « Inder
Ingabe…...Lieben……Je l'avais relevée quelque part avec l’intention
affirmée de la faire traduire un jour…...je l'ai perdue. Peut-être
qu’un jour je découvrirai une photo……vous qui lisez ces lignes, si vous
possédez cette photo, n'hésitez
pas à m'envoyer une copie.. Au
rez de
chaussée, le couloir desservait à gauche une famille composée des
parents et de 3 enfants déjà adolescents. A droite vivait un vieux
couple sans enfant. Je me souviens encore du nom de l'homme :
Barthélémy FERER. D'origine espagnole, tous deux avaient conservé un
accent "à couper au couteau". Notre logement était situé au premier
étage. Comme toutes ces vastes demeures du siècle passé, beaucoup de
place disponible était perdue par d'immenses escaliers desservant de
non moins immenses couloirs intermédiaires sur lesquels se cotoyaient plusieurs
portes d'entrée ; toutes à double battants et hautes de 3 mètres. Les
plafonds culminaient à 3 mètres 50 ou 4 mètres. Ces grands volumes
amplifiaient les sons, encore aggravés par la sale habitudes de
certains résidents : en guise de fermeture automatique des portes, ils
avaient installé....des tendeurs. Chaque entrée s'achevait toujours par
un violent claquement de porte qui raisonnait à l'infini dans les
couloirs.
Des
conditions de logement d'un autre
âge :
Notre
appartement se composait de deux uniques pièces mesurant au moins
vingt-cinq m²
chacune. Mes parents avaient pu se procurer un emplacement en
façade avec un grand balcon situé juste au dessus du perron de l'entrée
principale. Entre 1954 et 1955, les squatters musulmans quittèrent les
lieux, libérant toute l’aile droite du château. J’ignore ou ils étaient
partis mais une chose est certaine : ils furent bien plus avisés que
les autres dont les conditions en ces lieux étaient spartiates, même
pour les années cinquante, jugez plutôt : une absence totale
d'électricité. L’éclairage était assuré par des lampes à pétrole. Le
chauffage utilisait le charbon, héroïquement livré(en raison de l’état
de la route) par un commerçant du quartier de La Valentine appelé
ROSSO. Le bois mort récolté dans la forêt environnante assurait le
complément. Mais la pire des corvée restait l’eau. A un
kilomètre de là, un bassin avait été probablement créé pour les besoins
des plantations. Alimenté par une citerne dont on ignorait la
provenance du circuit la maintenant toujours pleine, il offrait un
bout de tuyau par lequel filtrait un filet sans pression. Remplir un
modeste seau de dix litres demandait au moins cinq minutes et le reste
à
l’avenant. Il fallait ensuite trainer ces seaux jusqu’au château.
Bien trop jeunes pour assurer ce travail, nous ne pouvions
qu‘accompagner nos parents ou rouler une grosse lessiveuse pleine d’eau
montée sur une méchante carriole bricolée par notre père. Cette
démarche devait se reproduire au rythme de l’usage que nous faisions de
l’eau. L’été, elle devenait presque quotidienne. L'essentiel du marché
en produits frais se faisait auprès des maraîchers environnants,
encore nombreux.
Le petit village de La Valentine contenait à peu près
l'essentiel des commerces susceptibles de satisfaire les besoins les
plus immédiats. Les grands magasins, ou les établissements très
spécialisés étaient implantés au voisinage de la
Canebière. S'y rendre était une expédition. D'abord franchir à pieds
les trois kilomètres séparant le château du village de La Valentine ;
prendre un bus de la Régis des transports locale jusqu'à la petite gare
de La Blancarde (plus de dix km d'une circulation de centre-ville très
dense) ou, du boulevard Chave, on prenait le célèbre (à l'époque)
tramway "68" un réseau terriblement utile car il conduisait gràce à un
tunnel ferrovière long de huit cents mètres, à la gare de Noailles,
appelé
également gare de l'Est. Elle aboutissait au centre de Marseille, à
quelques encablures de la Canebière et du marché de "la rue longue" ou
on pouvait se procurer à peu près n'importe quoi.
Je n'ai jamais vraiment intégré la culture
"marseillaise" : Mon père niçois et ma mère charentaise, ne
souhaitaient pas m'entendre adopter le "phrasé" marseillais. Chez nous
point de "té vé" (tiens regarde) de "cacarinette" (coccinelle) de
"chevingum" (chewing gum) de "dégun" (personne) ou de l'horrible "mon
vier" (grossièreté très marseillaise prononcée à tout bout de champ
exprimant le "membre viril") etc...etc...
Tous les cinq ou six ans ma
mère
nous entrainait rejoindre sa
famille d'origine dans la banlieue de Cognac en Charente à quelques
huit cents
kilomètres de Marseille. Je n'ai jamais connu pire expédition à partir
du château Vaudran. Chargés de valises et de paquets divers (parfois
avec le chien) il fallait rejoindre le bus de La Valentine à pied et
descendre au terminus gare routière du Cours Joseph-Thierry. De
là on rejoignait, toujours pédibus et chargés comme des mûles, la
grande gare Saint-Charles distante d'au moins trois km. Il fallait
prendre
le "rapide" Vintimille-Quimper qui roulait toute la nuit pour arriver à
Bordeaux au petit matin vers sept heures. Mes parents préféraient
rouler
la nuit. Les enfants pouvaient dormir, allongés sur les banquettes des
compartiments à l'ancienne. Je revois encore la longue file des
voyageurs entre chaque arrêt ; se postant devant l'entrée de notre
compartiment et lançant à mes parents "c'est pas normal ça" tout en
montrant
ma soeur et mes frères plongés dans un profont sommeil. C'était leur
manière de protester contre les dormeurs qui monopolisaient plusieurs
places assises. Dans l'immense gare de Bordeaux c'était la course pour
attraper la correspondance tantôt
vers Saintes, vers Angoulême ou la petite gare (disparue depuis bien
longtemps) de Beillant ou nous arrivions après dix-huit heures de
voyage.
Notre périple s'achevait en
taxi jusqu'à la ferme de mes
grand-parents maternels. C'était parti pour trente à quarante-cinq
jours de ballades
dans les champs, de baignades ou de pêches dans les superbes affluents
du fleuve Charente. De retour à Marseille, nous avions pris
l'accent pointu des charentais.
L'effrayante école primaire de La Valentine
Peu d’enfants ont dû parcourir autant de
chemin que nous pour rallier l’école primaire de La Valentine. (plan
d'accès de l'école)
Située aux confins des entrepôts de l’usine de
soda « Phénix », elle était à trois kilomètres de notre logement. Le
repas
de midi était pris en commun à la cantine de l’école. L’école primaire
de La Valentine, comme pour beaucoup d’enfants du quartier, a laissé un
très mauvais souvenir. Dans
les années 1958/1962, les enseignants
de l'école primaire de La Valentine laissaient les enfants se faire
piétiner par une horde violente plus ou moins téléguidée
par trois frères. Mal
surveillée, elle livrait
littéralement ses
élèves les plus jeunes à la brutalité de cette bande issue de certains
quartiers de La Valentine. Composée d’une vingtaine de préadolescents,
elle était entraînée par trois voyous qui se reconnaîtront facilement :
« Calou », le plus jeune et le plus vicieux ; « riri » l’aînés, presque
adolescent il était le plus calme. Mais très solidaire de ses deux
frères il n'hésitait jamais à cogner les plus faibles.
Mais Robert,
surnommé « gros » par ses camarades
était de très loin le plus violent. Personne ne peut imaginer le nombre
d’enfants que cette brute âgée de 13 ou 14 ans, a pu massacrer.
Je me souviens d’un certain GALLICCHIO, âgé de 8 ou 9 ans, qu’il a
presque étouffé en le serrant de toutes ses forces. Il a fallu
transporter le garçon auprès du médecin local. Entre 1958 et 1962,
cette bande a fait subir un véritable calvaire à ceux qui avaient le
malheur de se trouver dans leur colimateur. Pendant les
récréations, la quinzaine d' enseignants, se rassemblait au milieu de
la cour et bavardait tandis que les autres se faisaient
abîmer. Les frères "A", et surtout « gros », avait inventé un jeu très
subtil qui consistait à hurler « moulon » chaque fois qu’un enfant
tombait à terre. Pour les non marseillais, un "moulon" est un
amas, un tas ou un monticule, etc... Des dizaines de mômes de sa bande
(bien sûr les plus grands et les plus forts) plongeaient sur
l’infortuné et constituaient un paquet compact jusqu’à ce que plus
personne ne puisse tenir sur le sommet de la pyramide ainsi constituée,
pendant de longues minutes. Vous imaginez l’état de celui qui se
trouvait
dessous. Lorsque,
affolé de se voir visé par la bande, vous alliez vous plaindre au
groupe d'enseignants bavards, vous écopiez immédiatement d’une punition
: le fameux piquet. Ainsi vous étiez parfaitement à la disposition de
la horde qui pouvait vous asticoter sans courir. Combien de fois ne me
suis-je pas retrouvé ainsi puni puis frappé puis re-puni car
l’institutrice ne voyait que moi qui tentait de quitter le « piquet »
qui m’avait été assigné sans jamais voir ceux qui me tourmentaient. Le
pire restait à
venir avec la longue récréation entre midi et 14 heures, après le
déjeuner. Nous étions tous placés sous la surveillance indolente d’une
grand-mère, la dame S. qui ne s'intéressait qu’à son petit-fils
présent. Je la revois encore assise sur sa chaise à l'ombre d'un
platane au milieu de la cour. Elle passait son temps à tricoter,
gardant son petit-fils à côté d'elle (on sait jamais avec ces
petits voyoux qui frappent tout le monde). Mais devant
aussi peu de surveillance, c’était une véritable curée dans la cour de
récré. « gros », « calou » et sa bande s’en donnaient à cœur joie. Oui
c’était une bien belle école primaire celle de La Valentine, avec
monsieur Carminati à sa tête.
A une certaine période de l'année
scolaire, je n'ai
jamais compris comment naissait le mouvement, ni pourquoi il cessait,
pendant les récréations tous les enfants de l'école se mettaient à
jouer aux billes. Un jeu assez particulier. Au point qu'il n'avait pas
cours dans des écoles voisines d'à peine quelques kilomètres de là. Le
jeu consistait à s'asseoir par terre, jambe allongée. On posait une
bille en verre dans le demi-cercle ainsi formé. Il existait toutes
sortes de billes dont les plus belles étaient appelées "agates"
avec différentes couleurs. Plus la bille avait pour son propriétaire de
la valeur, plus il augmentait la distance de tir. Le jeu consistait à
atteindre cette bille avec des billes en terre de moindre valeur.
C'était un spectacle de voir tous ces gamins assis par terre appelant
le client à venir tirer sur sa bille dans des intonations proches des
marchandes des 4 saisons. Puis de voir d'autres enfants passer de l'un
à l'autre choisissant la bille la plus belle en jaugeant la distance
exigée par le propriétaire. Après avoir proposé une bille en verre, le
propriétaire qui avait la chance de récolter plusieurs billes en terre
parce qu'un tireur maladroit avait manqué plusieurs fois sa cible,
pouvait à son tour aller tirer d'autres billes. Les meilleurs tireurs
récoltaient le plus de billes. Le nec plus ultra était de récupérer une
énorme bille en verre que nous appelions "gallo". Dans d'autres régions
on l'appelle "calot". La distance imposée était importante et il
fallait tirer le gallo non plus avec des billes en terre mais des
billes en verre. (pour information il existe 9 tailles différentes de
billes en verre). Le propriétaire du gallo autorisait plusieurs tireurs
en même temps. Quelque fois cela finissait mal quand la bille était
touchée par plusieurs participants.
Robert A...,
vers la fin de cette période, s'amusait
à provoquer une forte émulation en jetant des billes en verre tout en
hurlant un mot tiré du patois provençal "à la rabaille" qui voulait
dire "à la mêlée". Dans la cour d'école tous les enfants se jetaient
sur les billes. "Gros" et son frère "riri" recommençaient cette
distribution chaque année. Tous les enfants ? Pas tout-à-fait. Les
élèves que ces messieurs avaient dans le nez n'étaient pas autorisés à
participer à "la rabaille". "riri" se foutait un peu de qui récupérait
les billes mais pas "gros" qui se précipitait sur l'infortuné gagnant
et reprenait "sa" bille puis recommençait à la lancer. Jusqu'à ce que
le jeu lasse les participants qui n'avaient aucune chance d'obtenir une
de ces billes. Quand les deux frères n'avaient plus de billes, la
plupart avaient été récupérées par les préférés. Personnellement je
n'ai jamais tenté de près ou de loin de participer à ce jeu car ayant
la certitude de me ramasser un mauvais coup de M. "gros"
Ma mémoire
fourmille encore d'anecdotes dans nos
relations avec le château et ses occupants ou l'école primaire de La
Valentine (avenue de la Tirane). Sauf erreur, les horaires de notre
école de garçons (dans les années soixante à Marseille pas de mixité)
étaient 8h30-11h30 le matin puis 14h-17h
l'après-midi. En 1961, pendant plusieurs semaines, presque tous les
soirs, Robert A. et ses deux copains (et voisins) les frères VERNE
m'attendaient en embuscade sur le chemin du retour. Postés dans un
champ à une centaine de mètres de l'entrée du domaine de Vaudran, ils
m'obligeaient presque tous les soir à me battre contre l'un des frères
VERNE
ayant sensiblement mon âge. L'aîné des deux frères et Robert A.
affichaient trois ou quatre ans de plus que moi. Il s'agissait
d'individus frustes et violents accusant un retard scolaire de
plusieurs années. Ils appartenaient à cette catégorie
d'adolescents qui attendaient leurs quatorze ans pour
quitter l'école et se mettre au travail (dans les années 60
l'obligation scolaire se limitait à quatorze ans. Les seize ans
survinrent bien
plus tard)
J'avais la chance d'être plus
fort que mon
adversaire. Après nous être roulé dans l'herbe plusieurs minutes,
immanquablement une voiture survenait sur la route. La petite bande
préférait se volatiliser dans la nature pour éviter les ennuis. En 1961
j'avais 10 ans. Ce type de bagarre enfantine ne laissait pas de trace
sur moi. Sauf peut-être quelques tâches vertes sur les vêtements
provoquées par le frotement sur l'herbe. Mais elle provoquait dans mon
esprit une grande fébrilité qui m'habitait jusqu'au château distant de
quelques centaines de mètres. Je me souviens en avoir informé mes
parents à plusieurs reprises, sans succès. En ce temps-là, qu'un enfant
se fasse casser la figure par d'autres élèves n'inquiétait pas les
parents outre mesure.
Je n'étais pas le seul enfant à
pâtir de la stupidité insondables des
frères VERNE ou de Robert A. Jamais ce dernier ne m'a brutalisé,
seulement humilié. La différence de gabari entre nous était très
importante à son avantage.J'avais dix ans. Il en avait treize ou
quatorze. Nous
l'appelions tous "gros" mais ce surnom était usurpé. Il n'était
pas gros du tout ; c'était une montagne de muscles, un hyper nerveux
qui n'hésitait
jamais à se manifester. Il était doué d'une force considérable pour son
âge.
Si je n'ai jamais souffert de sa violence, en
revanche il y en avait un dans ma classe qui ne pouvait pas en dire
autant. J'ai oublié son prénom. Il se nommait DELEGLISE. Là encore deux
frères étaient scolarisés à l'école primaire de La Valentine. Ce
dernier était le plus jeune. Son calvaire dura des mois. A l'école,
tout se sait. Nous savions tous que Robert A. avait une dent
contre lui et le pourchassait partout ou il le rencontrait. Une après
midi, vers 14h30. D... rentre en retard en classe. Bouleversé et
très énervé, il présente une large marque bleue sous un oeil. Il
raconte qu'une fois de plus Robert l'a coincé avant qu'il ne rentre
dans la cour de l'école et lui a administré plusieurs coups de poings
au visage. Il jure qu'à la sortie il va aller se plaindre auprès de la
gendarmerie de La Valentine. Dans les années 50, le bureau de
poste de La
Valentine était encore une baraque en pré-fabriqué abritant le cour
préparatoire de l'ancienne école primaire avant qu'elle ne s'installe
définitivement avenue de la Tirane. Après la construction de la
nouvelle école, la classe fut remplacée par une brigade de gendarmerie
qui dura quelques années. Nous avions l'habitude d'apercevoir un
gendarme de faction à l'entrée de cette brigade.
La
vengeance, un plat qui se
mange froid :
Je
ne sais pas
trop comment s'est terminée cette série d'agressions
dont fut victime D.... Durant les grandes vacances de l'été 1962,
ma famille eut la bonne idée de m'expédier 2 mois à Nice chez une
tante. Notre déménagement était imminent. Mes parents, comme tous
les squatters logés dans le château Vaudran, avaient effectué de
nombreuses démarches pour tenter d'être relogés dans des logements plus
dignes et surtout plus confortables (je rappelle que nous n'avions ni
électricité ni eau ni aucune commodité et que le village le plus proche
était à trois km d'un chemin difficilement carrossable). La guerre
d'algérie faisait rage. Mon père se tenait informé en temps réel grace
à l'installation d'un poste à galène fonctionnant sur pile. Le faible
signal audio obligeait le port d'écouteurs (on dirait maintenant un
casque). un million et demi de "pied-noir" allaient être rapatriés sur
la métropole. Plus de quatre cent mille restèrent à Marseille avec le
secret espoir
de revoir un jour l'Algérie Française.Des centaines de logements neufs,
plutôt des cités d'urgence au confort minimaliste, étaient en voie
d'achèvement dans les quartiers Nord de la ville. Nous faisions partie
des "mal logé" prioritaires. Je savais donc dès le début de l'année
1962 que je vivais ma dernière année à La Valentine et sa sinistre
école primaire. Ensuite ?....mystère ! mes parents pouvaient être
relogés n'importe où dans Marseille. A cette époque je ne me rendais
pas vraiment compte de la structure sociale de Marseille. Dans cette
ville où le soleil brille trois cents jours par ans (la plus
ensoleillée de
France) aujourd'hui encore il n'existe que deux types de logements :
les résidences louées ou vendues à des prix largement hors d'atteinte
des moyens de mes parents smicards et les HLM où s'entasse toute la
misère du monde. Mais il me tardait d'être relogé dans un appartement
ou l'électricité et l'eau courante n'étaient pas un vain mot.
Pour en revenir à Robert A..., en décembre 1961 vers quinze heures, mon
père m'avait déposé en scooter à proximité de l'école après une petite
visite médicale. Je devais rejoindre ma classe au plus vite. Devant la
grille d'entrée de l'école était stationnée une petite voiture dont
j'ai oublié la marque et le type. Au moment ou je m'apprétais à
franchir le portail, je vis Robert et deux ou trois individus, des
habitués de sa bande, fermer rapidement le capot de cette voiture.
J'ignorais totalement ce qu'ils avaient bien pu lui faire.
J'ignorais même s'ils y avaient fait quelque chose d'ailleurs. Mon
après midi à l'école s'est achevée sans incident. Mais c'est le
lendemain matin que tout s'accéléra. Une institutrice de l'école des
filles (une école qui touchait la nôtre) faisait le tour des classes de
l'école de garçons pour y délivrer le message suivant : quelqu'un avait
gravement endommagé sa voiture hier. En réaction, si les coupables ne
se dénonçaient pas, elle assurait priver de cadeaux de fin d'année
toutes les petites filles de sa classe. Une réaction fort injuste pour
des enfants qui n'avaient rien fait de mal. Il faut savoir qu'à cette
époque, la mairie de Marseille offrait chaque année à Noël à tous les
enfants du primaire une poche contenant mandarines, chocolats, nougats
et autres sucreries. Pour les plus petits des classes du cours
préparatoire et du cours élémentaire, des jouets étaient également
offerts.
Cette enseignante était furieuse. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris de
lever le doigt. La nouvelle année 1962 allait
arriver dans quelques semaines. Je savais que mon séjour dans cette
école allait s'achever. Et j'ai balancé Robert A. en racontant ce que
j'avais vu la veille. J'avais fait le
rapprochement entre la présence de cette bande à proximité de
la voiture et les dégradations qu'elle avait subie. Je ne me
rendais pas bien compte des risques que je prenais. Le lendemain, A.
et sa bande étaient plantés mains derrière le dos face à un mur. Tous
pleuraient à chaudes larmes. Mais aucun d'entres eux n'exerça de
représailles. Le directeur de l'école de garçons (Carminati) et la
propriétaire du véhicule prirent leurs dispositions pour que je
ne sois jamais inquiété. Ce fut une façon de me témoigner leur
gratitude. Les vacances scolaires de Noël passèrent puis la rentrée et
les grandes vacances. Je n'eus plus jamais à me plaindre des
agissements de Robert et sa bande. Plus tard, après avoir été relogé
dans le 13eme arrondissement, quartier des Olives, il m'arrivait de me
rendre à pieds au canal qui longeait le château Vaudran, désormais en
ruine. Avec quelques amis nous prenions le bain dans les eaux courantes
de ce petit canalet. Il nous arrivait d'y croiser Robert et sa
bande, venus faire la même chose que nous. Il n'y eut jamais de
confrontation ultérieure. On se contentait de s'ignorer.
En 1962, la
mairie de Marseille avait acquis d'immenses terrains dans les quartiers
Nord
pour y loger en urgence l'afflux important des pieds-noirs. Devant le
danger
représenté par l'état alarmant du château Vaudran, nos familles furent
relogées
dans ces vastes cités-ghettos. Nous étions cinq
enfants dans les deux pièces de notre appartement du château. Pour me
montrer
que le sol se creusait dangereusement, mon père faisait rouler une
bille sur
les belles tomettes rouges. Elle filait rapidement contre les plinthes.
Les
quelques familles de squatters avaient tenté de nombreuses demandes de
relogement. Il devenait urgent d'évacuer tout le monde.
Cette année de
juillet 1962, j'avais onze ans. Mes parents furent relogés dans la cité
HLM des
Olives, avenue des Poilus. J'étais à Nice
chez une sœur à mon père. Je n'ai découvert mon nouveau quartier qu'un
mois
plus tard. Les corvées
d'eau étaient enfin terminées ; électricité dans toutes les pièces ;
chauffage à mazout. De
nouvelles corvées nous attendaient pourtant : la bouteille de gaz
butane (pour
une raison que j'ignore, mon père ne voulut jamais utiliser le gaz de
ville
pourtant bien plus commode) et surtout les jerricans de mazout de 10
litres
chacun pour l'unique chauffage de l'appartement.
Le confort de
notre nouvelle résidence n'a jamais fait oublier "mon" château. Avec
quelques camarades nous avions l'habitude de nous y rendre à pied. Il
fallait
compter environ quatre kilomètres en empruntant la Traverse du
Commandeur
(les
Olives) puis la Route d'Enco de Botte (3 Lucs), la traverse de La
Langouste.
Nous arrivions dans le vaste domaine de Vaudran-La Salette (on ne sait
pas trop
ou commence l'un et ou s'arrête l'autre). Nous arrivions au château par
le
grand bassin qui desservait l'unique point d'eau de l'époque.
Un
terrible drame dans le bassin du château Vaudran :
Ce lieu fut le
témoin d'un drame. Cela peut paraître curieux ! pourtant malgré mes
trois
ans, je
n'ai jamais oublié la scène de ce dimanche d'été 1954. Toutes les
familles du
château se pressaient autour du bassin pour la corvée dominicale d'eau
ou de
lessive. Le bassin circulaire avait dû servir de réservoir pour le
château dans
sa jeunesse. Il arrivait parfois qu'il fût plein à ras bord. J'ignore
qui
manœuvrait les vannes (je ne sais même pas ou elles se trouvaient
d'ailleurs) Ce dimanche-là
le bassin était plein. Les hommes les plus âgés s'y baignaient parfois.
Un
garçon de huit ans du nom de Brachet (j'ai oublié son prénom) se
penchait
au bord
du bassin pour capturer des têtards. J'entends encore les femmes lui
crier sans
cesse de ne pas se pencher. Puis soudain le drame. Vu mon âge, je ne
comprenais pas ce qu'il se passait mais ma mémoire a fortement imprimé
la scène
suivante : ma mère me pris par la main et m'entraina vers le château en
courant.
Mon père était
resté sur place avec les autres. Plus tard nous apprîmes que "le petit
Brachet" était mort noyé. En chutant dans l'eau il avait remué
énormément de vase. Les nageurs qui s'étaient précipités dans l'eau
pour le
repêcher ne parvenaient pas à le retrouver. Quand le corps fut remonté
il était
trop tard.
Ses parents
occupaient la petite maison située à l'entrée du château Vaudran à
gauche, tout
de suite après les deux colonnes qui soutenaient la grille. On appelait
cet
endroit "la maison du concierge". Par rapprochement la famille
Brachet était devenue "la famille du concierge". Ce qu'ils n'étaient
probablement pas. Je pense que le drame ne fut pas étranger à leur
départ vers
l'inconnu. Par la suite nous fumes habitués à voir cette maison fermée
à tout
jamais. Dans ma petite tête je me disais que nous serions bien mieux
dans cette
maison qui devait bénéficier de tout le confort moderne.
La
destruction du château :
A partir de
1975, je rendais régulièrement visite à "mon" château
pour voir "comment il allait". Cette fois j'était accompagné de mon
épouse ; quelquefois par des éléments de ma famille ; puis avec nos
enfants.
Les propriétés à l'abandon se faisaient déjà rares dans le Marseille
des années
70. C'était aussi une occasion de "prendre le bon air" comme on dit à
Marseille. Cette fois plus
de longs parcours à pied. On venait en voiture jusqu'au "champ" Nous
appelions ainsi une grande prairie située à quelques centaines de
mètres de
l'entrée principale du domaine. Puis nous poursuivions à pied les deux
ou
trois cents
mètres qui nous séparaient du château dont on apercevait déjà les
cheminées.
En
1976, un de
ces dimanches, un
terrible détail me saisit à la gorge : en garant notre voiture dans le
"champ" je ne me rendis pas compte tout de suite que quelque chose
avait changé ! Quand nous prîmes le dernier chemin d'accès légèrement
montant,
je ne vis pas "mon" château. Je me revois encore partant en courant
vers lui. Il avait disparu ! A sa place une large fissure dans la
petite
colline
contre laquelle il était appuyé. Le château Vaudran n'était plus. Mon
épouse
tentât de me consoler comme elle pouvait. Je n'ai jamais oublié ce
jour.
Pourtant je savais qu'il viendrait. L'édifice faisait l'objet d'un
arrêté
municipal de péril. Un accident était possible à tout moment.
Par la suite
nous continuions à nous rendre de temps en temps dans le domaine de
Vaudran.
Jusqu'à ce que d'importants travaux de terrassements marquent
définitivement la
fin de la récréation.
Mais je n'en
avais pas terminé avec les châteaux : Puisque le mien n'était plus là
nous
prîmes l'habitude de nous rendre dans la grande et belle propriété du
château
de la Buzine, ancienne acquisition de Marcel-Pagnol. Là encore, des
travaux
marquèrent de nouveau la fin de la récréation par l'implantation de
dizaines de
villas.
|

Requiem pour un château